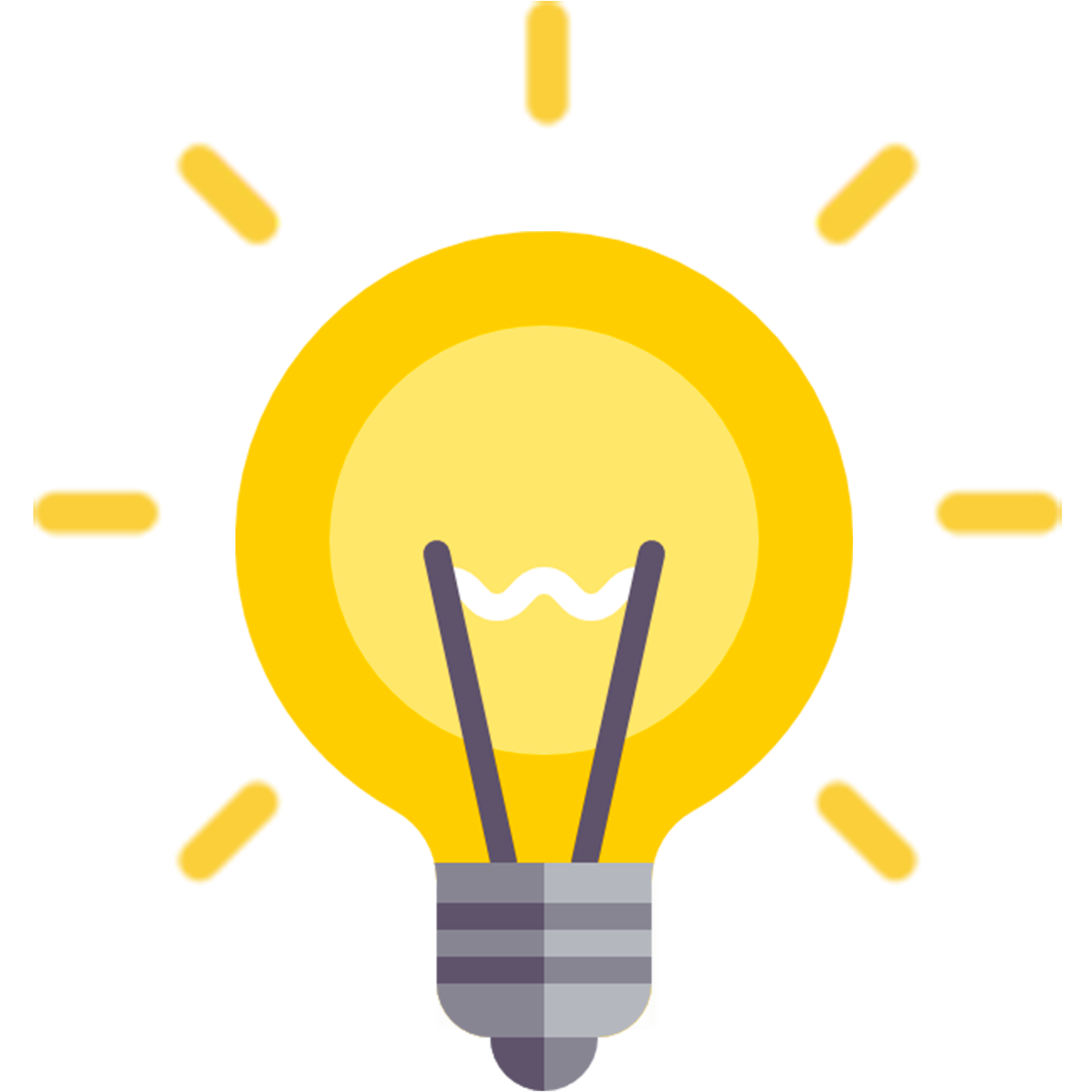- cross-posted to:
- [email protected]
- [email protected]
- cross-posted to:
- [email protected]
- [email protected]
cross-posted from: https://sh.itjust.works/post/20488014
Ci-dessous je partage un article du Diplo en relation avec mon post d’hier Abonnez-vous si vous le pouvez 👍
En 1955, ABC diffuse Man in Space. Quarante-deux millions de téléspectateurs regardent ce documentaire produit par les studios Disney ; la moitié des Américains l’auront vu après sa rediffusion en 1956 ; et 38 % d’entre eux estimeront possible d’aller prochainement sur la Lune contre 15 % en 1949 (1). Des romans de Jules Verne à Interstellar (Christopher Nolan, 2014), la fiction présente la conquête spatiale comme l’accomplissement d’un rêve. L’assouvissement d’un désir naturel, universel, atemporel. Pourtant, il a fallu fabriquer le consentement à l’espace. Les retombées scientifiques que permettrait son exploration ou la conscience planétaire née des images satellitaires de la Terre y ont contribué. De même que la figure de l’astronaute et son héroïsation.
Les astronautes incarnent non seulement le voyage vers l’espace en tant que tel, mais aussi les valeurs de leur pays d’origine. Youri Gagarine, premier homme placé en orbite en 1961 par l’URSS, est avant tout choisi en raison de ses origines paysannes modestes et de son parcours collant ainsi au plus près à l’idéal de l’homme soviétique. Beaux, mariés à de belles femmes, loyaux, patriotes, blancs, émotionnellement stables, prêts à prendre des risques… les États-Unis sélectionnent dès 1959 les sept astronautes du groupe « Mercury Seven » — les tout premiers — avec cette même idée de représenter le peuple américain. Talentueux pilotes de chasse, ils personnifient la compétence en matière technologique, le sens du devoir et le courage nécessaire à l’accomplissement d’une mission sacrée au service de leur pays. Les foules les adulent avant même qu’ils n’aient parcouru le moindre kilomètre à la verticale.
Les critères physiologiques qui préjugent de leur sélection sont cependant encore peu clairs. Les premiers tests réalisés par le National Advisory Committee for Aeronautics (le NACA, devenu la National Aeronautics and Space Administration [NASA] en 1958), censés attester leur fiabilité, semblent avoir été conçus pour les conditionner et les humilier au maximum : ils sont photographiés nus, soumis à différents appareils intrusifs et à toutes sortes d’expériences. L’idée même de recruter des pilotes de chasse ne va pas de soi. Avant que le président Dwight Eisenhower ne valide ce choix, tout est envisagé : joueurs de base-ball, trapézistes, alpinistes, médecins ou professeurs. Mais, à la fin des années 1960, l’agence cherche avant tout un profil de « superman ordinaire », selon la formule de l’historien Gerard DeGroot (2) : le gendre idéal et bien rangé auquel tout le monde peut s’identifier, de préférence pas trop exubérant. Les pilotes sont donc des militaires, dociles, dotés des bonnes habilitations de sécurité et familiers des combinaisons pressurisées.
Leurs premiers pas dans l’environnement naissant qu’est l’astronautique ne sont pas simples. Aux débuts de l’ère spatiale, les Mercury Seven font face au double défi de démontrer leur utilité à l’extérieur, vis-à-vis du grand public, comme à l’intérieur, face aux scientifiques et aux ingénieurs dont les corps de métier sont déjà constitués. Les premiers êtres vivants envoyés dans l’espace par les Américains sont des singes, et il s’agit pour les astronautes d’expliquer en quoi leur présence là-haut a plus de valeur ajoutée que celle des primates. La réalité du métier se résume alors à s’asseoir dans une capsule exiguë et à supporter ses turbulences jusqu’à la mise en orbite. Une fois dans l’espace, il n’est pas encore question de batifoler en apesanteur. Puis viennent la redescente et de nouvelles turbulences lors de cette opération très risquée de rentrée dans l’atmosphère terrestre. Les scientifiques, peu enthousiastes à l’idée de s’embarrasser de systèmes de survie lors de vols largement automatisés, pensent même à droguer les astronautes dans la capsule, non pas pour les protéger des désagréments du voyage, mais pour éviter qu’ils n’appuient sur le mauvais bouton. À bord, ils n’ont alors pas plus d’autonomie qu’un passager d’une compagnie aérienne classique, qu’on « autorise à ajuster son siège, sa tablette et le volet du hublot », ironise DeGroot.
Des pionnières socialistes
De prime abord, l’idée de rendre publique la vie des astronautes ne récolte pas les faveurs des dirigeants politiques américains ni celles de la NASA. D’abord réticents à laisser filer l’image de leurs poulains dans les médias de masse, ils finissent néanmoins par s’y résigner, y voyant un avantage certain pour maintenir l’intérêt du public pour le vol habité. Les Mercury Seven sont autorisés à vendre leur image à Life en 1959, sous réserve que le magazine s’en tienne à leur vie privée officielle et au soutien inconditionnel de leurs familles et de leurs enfants à leurs dangereux exploits. Les nombreuses affaires extraconjugales, pourtant bien connues des reporters, sont passées sous silence. Plus généralement, la vie des astronautes est idéalisée, alors que leurs tâches s’étendent à ce qu’il convient de nommer une « fonction promotionnelle » : ils partent en tournée et répètent à l’envi les mêmes discours dans des écoles, à l’occasion de séminaires de motivation en entreprise…
En quelques années à peine, ils se muent en icônes culturelles : de nouveaux héros symbolisant la toute-puissance technologique des États-Unis, et aussi une certaine idée de la masculinité et de la virilité. Les premières combinaisons d’astronautes du programme Mercury sont peintes à la bombe argentée pour leur donner un aspect plus futuriste. Au cinéma, ils sont experts en combat rapproché dans le James Bond de 1967, On ne vit que deux fois, et armés de lasers dans une scène épique de Moonraker en 1979. Et il n’est toujours pas question d’envoyer des femmes dans l’espace, malgré des performances physiques similaires sinon meilleures que celles des hommes, et malgré le premier vol spatial de la Soviétique Valentina Vladimirovna Terechkova en 1963 — il faudra attendre encore vingt ans pour qu’une Américaine, Sally Ride, s’y rende.
Après la conquête de la Lune, en 1969, la célébrité et l’héroïsme ne suffisent plus à légitimer la présence d’astronautes dans l’espace. Pour recueillir un maximum de soutien, la NASA a besoin d’un nouveau récit, et d’employer des métaphores dépassant les habituelles références à la frontière. Dès les années 1970, et plus encore dans les années 1980, ce récit valorise la routinisation de l’accès à l’espace (à bord de la navette spatiale), et sa déclinaison humaine, l’astronaute comme travailleur orbital, chargé de monter la station et de réaliser des expériences scientifiques à son bord. « Aller dans l’espace rime avec aller au travail », écrit l’historienne Valerie Neal (3). Des années durant, les astronautes construisent en orbite des stations, morceau par morceau, une activité que de nombreuses images illustrent à l’envi. Côté soviétique, des cosmonautes issus de pays alliés sont invités dans la station Saliout. On compte parmi eux le Vietnamien Pham Tuan en juillet 1980, pilote ayant abattu un avion américain B-52 pendant la guerre du Vietnam et premier Asiatique dans l’espace : la machine symbolique tourne à plein régime. Depuis l’orbite, il constate les dommages environnementaux produits par l’usage d’agent orange, un défoliant déversé par l’armée américaine au-dessus des forêts vietnamiennes et sur des cultures vivrières de 1962 à 1971.
Les décennies 1980 et 1990 voient également voler plus de femmes et de personnes non blanches. La NASA comprend bien la nécessité de mieux représenter la diversité de la population dans l’espace, alors que les critiques vont bon train quant à l’utilité de la navette, et plus largement de la science en orbite. L’idée que n’importe qui peut voler dans l’espace atteint son paroxysme en 1986, quand la professeure des écoles Christa McAuliffe est sélectionnée pour un vol sur Challenger dans le but d’inspirer les élèves du pays. La navette explose après soixante-treize secondes de vol. C’est un drame national qui rappelle que malgré la routinisation du vol spatial (encore loin d’être acquise), ce n’est pas une activité comme les autres.
À l’aune de ces événements, il faut lire le rôle actuel des astronautes aux États-Unis, en France ou encore en Chine. Comme Gagarine et les Mercury Seven, l’astronaute Thomas Pesquet occupe aujourd’hui, en France, une triple position de héros, de vedette et d’homme ordinaire. On en est fan comme on adore Jenifer, l’abbé Pierre et Jean-Jacques Goldman, tout en reconnaissant que l’homme de l’espace est le fruit d’une super-sélectivité. Ce statut de héros moderne se marie ainsi parfaitement avec l’idéal de l’homme simple, celui qu’on apprécie précisément parce qu’il ne complexe pas ses admirateurs. Dans un livre où il s’interrogeait sur l’utilité du voyage sur la Lune, le philosophe Günther Anders remarquait déjà que les astronautes étaient héroïsés autant que « médiocrisés » car, « pour être admiré comme un héros dans les démocraties de masse, les individus doivent être d’une nature telle, ou du moins être présentés de telle manière que tout le monde puisse se reconnaître en eux et s’identifier » (4).
Ces gars du coin assurent et rassurent, tant par leur compétence que par leur proximité et leur normalité, à l’image du Canadien Chris Hadfield, qui, depuis la Station spatiale internationale, explique l’importance de se relier aux gens y compris « en se filmant, [se] rasant, buvant et mangeant des cacahuètes en apesanteur (5) ». Car l’astronaute du XXIe siècle est aussi un influenceur adepte des réseaux sociaux numériques, bien que ses interventions soient largement contraintes par les lignes directrices des agences employeuses : avoir une attitude positive, s’en tenir aux déclarations convenues sur la beauté de la Terre et la fragilité de son climat, ne pas trop aborder la pollution due au nombre croissant de débris dans l’espace. L’astronaute italienne Samantha Cristoforetti a pris le parti de pousser les jeunes générations à s’intéresser aux carrières scientifiques : elle sert de modèle (role model), notamment via un partenariat avec Mattel, qui vend une poupée Barbie à son effigie.
7,5 millions de dollars par jour
Ces éléments expliquent pourquoi M. Pesquet, 550e homme à partir dans l’espace et 10e Français, jouit, depuis les années 2010, d’une telle célébrité, bien plus forte que celle de ses prédécesseurs. Une célébrité parfaitement orchestrée et chorégraphiée par l’Agence spatiale européenne (ESA). Qu’il s’agisse de sport, de musique ou d’enjeux caritatifs comme les Restos du cœur, M. Pesquet est partout et cultive cette image de gars sympa à qui rien ne peut être décemment reproché. L’astronaute sait y faire, titillant les sentiments patriotiques ou régionalistes avec ses photographies choisies (la Bourgogne et ses vins à la réputation internationale « amplement » méritée, la Bretagne, cette « silhouette familière » qui ferait un joli fond d’écran), livrant ses pensées poétiques sur le dérèglement climatique tout en immortalisant les incendies en Grèce, au Canada, en Californie ou en Turquie en 2021.
La double casquette de vedette nationale et d’ambassadeur des programmes habités présente l’avantage de s’adapter aux différentes revendications sociales pouvant surgir ici et là. La direction de la NASA, par exemple, est tout à fait lucide quant au manque de représentativité de ses astronautes, qui sont encore aujourd’hui très majoritairement des hommes blancs. Personne ne le dit mieux que Mme Lori Garver, administratrice adjointe de l’agence de 2009 à 2013 : « Diversifier les équipages d’astronautes fournira des “role models” et des bouffées d’espoir pour les gens qui ne se voient que rarement représentés dans de telles positions (6). » C’est bien pour cette raison que les États-Unis ambitionnent d’envoyer sur la Lune la première femme et la première personne « de couleur » dans le cadre du programme Artemis, qui prévoit le retour d’astronautes sur la Lune en 2026. Après s’être inscrite dans la lignée des acteurs du petit et du grand écran, après avoir intériorisé les inquiétudes écologiques, la figure de l’astronaute pourra incarner l’apaisement à l’endroit des injustices de genre, de race, de handicap.
Quant à savoir à quoi servent les astronautes, leurs stations, leurs recherches, c’est bien là un serpent de mer. Le coût d’une journée sur la Station spatiale internationale s’élève à 7,5 millions de dollars par astronaute, lancement compris, soit 315 000 dollars de l’heure. À ce tarif, difficile de justifier des études scientifiques menées à bord (7). Un argument souvent employé pour leur trouver une utilité consiste à rappeler que ce sont cinq visites humaines depuis la navette spatiale qui ont permis de réparer en orbite le télescope Hubble en 1993. Mais cela s’est alors fait au prix de la construction et de l’envoi de sept télescopes équivalents…
Irénée Régnauld & Arnaud Saint-Martin Respectivement consultant et sociologue. Auteurs d’Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, dont ce texte est adapté, à paraître le 2 février, La Fabrique, Paris, 2024.
(1) David Meerman Scott et Richard Jurek, Marketing the Moon : The Selling of the Apollo Lunar Program, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2014.
(2) Gerard DeGroot, Dark Side of the Moon : The Magnificent Madness of the American Lunar Quest, Vintage, Londres, 2008.
(3) Valerie Neal, Spaceflight in the Shuttle Era and Beyond : Redefining Humanity’s Purpose in Space, Yale University Press, New Haven, 2017.
(4) Günther Anders, Vue de la Lune. Réflexions sur les vols spatiaux, Héros-Limite, Genève, 2022.
(5) Olivier Dessibourg, « “L’exploration spatiale n’a rien de magique, c’est juste de l’exploration” », Le Temps, Genève, 22 mai 2016.
(6) Lori Garver, Escaping Gravity : My Quest to Transform NASA and Launch a New Space Age, Diversion Books, New York, 2022.
(7) Donald Goldsmith et Martin Rees, The End of Astronaut : Why Robots Are the Future of Exploration, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2022.
Courrier des lecteurs
À la suite de l’article « Comment fut inventé l’astronaute » (février), M. François Saint Lager, professeur dans le secondaire en Belgique, livre ses réflexions sur les conséquences de la privatisation croissante des vols spatiaux :
L’intérêt d’envoyer des humains dans l’espace peut certes à l’avenir poser question avec l’emploi de l’intelligence artificielle. Mais la privatisation de l’« exploration » spatiale ouvre de nouvelles perspectives sur au moins deux plans : d’abord, le crépuscule de la volonté, après la seconde guerre mondiale, de rendre neutre diplomatiquement l’espace, un bien collectif commun de l’humanité ; et, naturellement, ensuite, sa transformation désormais en un « espace » commercial ouvert à l’exploitation touristique pour une très petite minorité. Dans ce contexte, le voyageur spatial ne sera plus un être sélectionné en fonction de qualités requises, qu’elles soient physiologiques ou autres, comme le démontre très bien l’article, mais celui qui sera en mesure de payer.