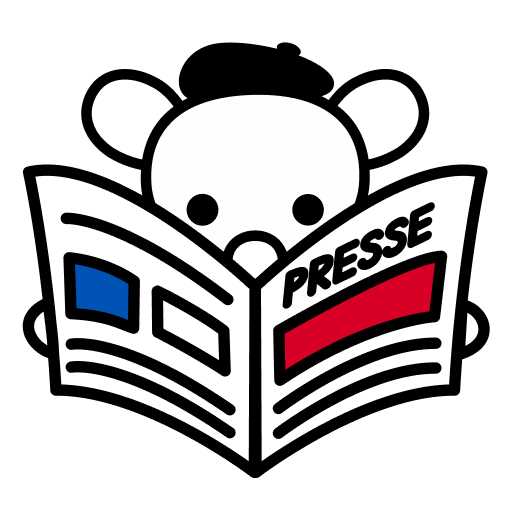- cross-posted to:
- [email protected]
- cross-posted to:
- [email protected]
Si le cas Delhaize touche tant, c’est qu’en Belgique, la marque fait presque partie du patrimoine national, avec ses magasins siglés d’un lion noir et son « capitalisme familial » qui remonte au XIXe siècle. « Ce conflit a été marqué par la négation de la concertation sociale à la belge, ingrédient très important du fonctionnement socio-économique du pays », décrypte Jean Faniel.
Dans un pays où le taux de syndicalisation avoisine les 50 %, où l’on règle en général les conflits dans les organismes paritaires de concertation, ce refus obstiné de négocier reste difficile à encaisser par les syndicats. Le mouvement social, lancé en mars, n’a pas pour autant été inutile. Les syndicats ont décroché l’obtention d’une prime pour le transfert vers des entités franchisées. La garantie, pour les employé·es, de conserver leurs conditions de travail. Mais la franchisation a bien eu lieu, à marche forcée.
La grande nouveauté de cet épisode, c’est l’immixtion d’ampleur de la justice dans un conflit social. À vingt-cinq reprises, les dirigeants de Delhaize ont dégainé l’arme juridique, via des requêtes unilatérales en extrême urgence, pour interdire aux grévistes de fermer des magasins, de tenir des piquets de grève et même, dans certains cas, pour les empêcher de distribuer des tracts aux client·es au nom d’une « entrave psychologique » que subiraient ces derniers. Des juges ont suivi les arguments de Delhaize, intimant aux « bloqueurs » de laisser l’accès libre aux magasins, sous peine d’astreintes.